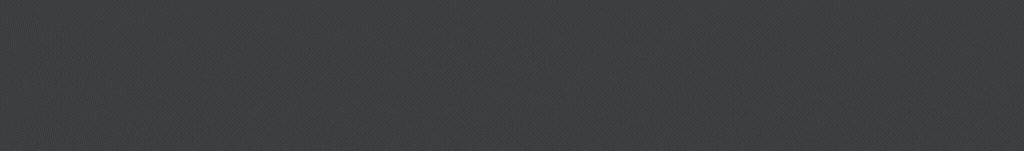Scoopsdeziguinchor.com : Depuis quelques années que le Sénégal a adopté la réforme Licence-Master-Doctorat (Lmd), l’Université est devenue le champ de toutes les contestations. Une situation que l’on retrouve plus globalement dans tout le secteur éducatif sénégalais. Résultat, l’école sénégalaise est malade. En marge de la deuxième édition du «Gingembre littéraire» qui s’est tenue les 4 et 5 décembre dernier entre Ziguinchor et Sédhiou, Dr Jean Alain Goudiaby, qui pose ce diagnostic, propose également des solutions.
Lors de votre intervention au Gingembre littéraire, vous avez dit que la réforme Lmd a été faite sans que l’on prenne en compte les réalités de l’école sénégalaise…
Le principal point de départ de la réforme Lmd a été d’abord parce que ça a été pensé en Europe et il nous fallait nous arrimer à un modèle, celui du 3, 5, 8. Et du coup, transformer nos réformes, nos diplômes pour qu’ils soient en conformité avec ce modèle. Sauf qu’en le transformant, on n’a pas suffisamment pris en compte les réalités, c’est-à-dire qu’est-ce qu’on a pris en compte en amont pour l’introduire dans la réforme. Il ne s’agissait pas simplement de dire qu’on avait des diplômes calibrés d’une certaine manière qu’il fallait calibrer d’une autre, mais il aurait fallu davantage voir quelles étaient nos réels besoins, quelles étaient les compétences dont nos étudiants ont besoin, quelle était la structuration du travail pour pouvoir faire les réformes. Et ça, je trouve qu’on ne l’a pas suffisamment fait.
Et ça pose la question de l’inadaptation des curricula…
Ça va du primaire au supérieur. La réforme curriculaire n’est pas simplement à faire à la va-vite. Ce n’est pas parce qu’une pédagogie marche ailleurs qu’elle marche pour nous et dans le contexte actuel. Il y a ce qu’on appelle la revanche des contextes, c’est-à-dire qu’il y a des réalités, même si on ne les prend pas en compte, non seulement la réforme ne va pas être pertinente, mais elle ne va pas produire ce pour quoi elle a été pensée. Qu’on fasse des réformes, il en faut. Mais il faut d’abord qu’elles soient pensées en lien avec nos besoins. Mais il faut d’abord qu’on fasse le travail pour connaître et identifier nos besoins. Le principal point de départ, c’est de voir quels sont nos besoins et dans quelle mesure elles sont prises en compte.
Ce travail a-t-il été fait ou est-il en train d’être fait ?
Les chercheurs font ce travail-là. Le ministère aussi, je suppose. Mais la grosse difficulté, c’est est-ce qu’il y a un lien entre ceux qui décident et ceux qui produisent la connaissance ? A ce niveau-là, il y a une faiblesse qu’on note au Sénégal. On a des chercheurs qui cherchent, des administratifs et des politiques qui font leurs politiques. Et moi je plaide depuis des années pour qu’il y ait des espaces où chercheurs et décideurs doivent pouvoir se retrouver pour construire des politiques éducatives fiables, solides et qui s’inscrivent dans la durée.
Est-il encore possible de changer cette réforme Lmd ?
Toute réforme que l’on fait peut être améliorée. Nous avons la révision régulière des maquettes, des contenus de formation. Cette révision régulière doit être faite et elle prend en compte ce qui n’a pas marché et intègre les besoins du marché, de nos sociétés, de nos communautés. Et c’est un travail qui est possible. Mais encore faudrait-il s’en donner les moyens. Cela veut dire être d’accord que c’est ce qu’il faut faire et se donner les moyens de faire cette étude.
Vous-même qui faites des recherches sur l’éducation, avez-vous des connexions avec les autorités ?
Personnellement, j’en ai. En ce moment même, je conduis une recherche avec le ministère de l’Education nationale sur le plan riposte Covid-19. Mais ce travail gagnerait à plus être fait et sur toutes les questions.
Il y a aussi le fait que les résultats de la recherche ne correspondent pas toujours aux agendas des autorités politiques…
Quand on fait une recherche, évidemment les résultats ne sont pas dictés. On trouve ce que l’on trouve. Ça peut ne pas faire plaisir, mais c’est ce que l’on trouve. On ne fait pas de la recherche pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous mettons en place un dispositif qui se veut scientifique. Nous produisons de la connaissance et cette connaissance, qu’elle plaise ou non, c’est ce que la réalité nous donne. On est sociologue et quand on fait de la sociologie, ce n’est pas pour plaire aux politiques, mais il est important que cette sociologie puisse être entendue et «entendable». Au final, la démarche des politiques s’adosse sur des dynamiques sociales et ceux qui étudient les dynamiques sociales restent grandement les sociologues.
Tout le monde est d’accord pour dire que l’école sénégalaise va mal. Selon vous, où se situe le problème ?
L’école va mal parce qu’il y a un défaut de formation des formateurs, il y a un défaut d’accompagnement de la formation, matériel aussi. Si vous regardez, il y a une disparité de nos écoles, il y a une politisation de l’espace éducatif qui, à mon sens, n’a pas lieu d’être. Il y a une forme de remise en cause de l’intérêt même que l’école suscite au sein de nos communautés. Aujourd’hui, le modèle de réussite n’est pas l’école seulement. On voit des gens qui réussissent sans aller à l’école. Alors du coup, les jeunes se disent pourquoi continuer à aller à l’école alors que c’est difficile. Cela est le résultat de la combinaison de plusieurs choses. Il y a des choses qui sont institutionnelles ou structurelles parce qu’il n’y a pas les moyens. Et après, c’est une réflexion globale : quelle école voulons-nous ? Si l’on se dit qu’on est prêt à mettre les moyens, et je ne parle pas seulement de chiffres, de montants, il faut aussi que les moyens soient bien utilisés. Ça ne sert à rien de lettre un gros budget s’il est gaspillé. Il y a beaucoup de choses qui expliquent que notre école est comme ça, mais malgré tout je dis qu’on n’a pas le droit de désespérer de cette école-là. Elle a produit des cadres et elle continue à le faire malgré tout. A nous de continuer à y croire et comme je dis souvent, que ce qui doit être fait le soit au moment où ça doit l’être.
Est-ce que vous sentez un désir de changer cette école de la part des acteurs comme de l’Etat ?
Oui et non. Il y a des acteurs qui croient encore à l’école et qui se battent pour elle. Malheureusement, on a aussi des gens qui sont dans l’école pour des besoins personnels, se faire de l’argent, j’ai envie de dire. Mais il y a beaucoup de ces gens qui gâtent l’école de l’intérieur. L’engagement citoyen, militant, l’engagement de l’enseignant en tant que vocation, il y a un effritement à ce niveau-là. Et c’est la même chose qu’on peut retrouver chez les administrateurs. Il y a des gens qui sont dans l’école par infraction et qui n’ont rien à y faire.
Quand on dit école, on a tendance à penser à l’école française. Ce n’est pas la seule…
L’école n’est pas seulement française. Il y a l’école coranique, communautaire, l’école des savoirs. L’école n’est pas seulement cette institution où on apprend, comme on dit «i, o, a». Non. On doit pouvoir apprendre «alif» et tout le reste. On doit même pouvoir apprendre dans nos langues. Sauf que dans nos schémas, on a simplifié la chose en considérant que l’école, c’est celle du Blanc. L’école est plurielle et dans nos communautés, nous gagnerions d’ailleurs à avoir cette vision plurielle de l’école qui peut aussi offrir différents types de formations parce que le principe c’est comment nous préparons ces jeunes et on peut les préparer de diverses manières et on peut les préparer même sans pour autant qu’ils sachent parler le français correctement.
L’introduction des langues nationales pourrait-elle améliorer la situation ?
Tout dépend de comment on l’introduit. Réformer pour réformer, dire que j’introduis une langue nationale ici et là sans pour autant le penser avec l’ensemble, ne me semble pas pertinent. Il faut introduire les langues nationales parce que ça a du sens pour apprendre un certain nombre de choses. Parce que ça correspond au référentiel des enfants, à un univers lexical, sémantique, représentationnel, donc c’est important. Mais il ne faut pas simplement dire, nous introduisons des langues, on va écrire en diola, en mandingue, Sarakolé et diahanké et ça suffit. Il faut regarder quelles sont les compétences derrière et l’introduction va servir à quoi. Il faut réfléchir sur le sens des réformes et ne pas faire pour faire. Il faut réfléchir sur le sens et la portée de toute réforme.
Nous sommes en Casamance et les abris provisoires sont assez nombreux. Est-ce que l’enfant qui commence sa classe dans ce genre de milieu, qui est défavorisé par rapport aux autres, aura des séquelles dans son futur ?
L’enfant sait qu’il est défavorisé. Il peut en avoir conscience. Et quand il en a conscience, il se pense déjà inferieur aux autres. Et ça, ce n’est pas normal. Il ne devrait pas y avoir d’abris provisoires ni ici ni ailleurs. C’est pourquoi je disais que l’école, il faut lui donner «gueudam» en wolof, c’est-à-dire qu’on doit lui donner ce qu’elle doit être. Si nous voulons que l’école joue son rôle, nous devons lui donner ou lui redonner ses lettres de noblesse. Et ça passe par le cadre. Si vous avez quelque chose de bien, de suffisamment soyeux, intègre, vous y allez avec plaisir et vous apprenez avec plaisir. Vous en sortez grandis. Par contre, si vous mettez des gens dans un cadre lamentable, ils ont conscience de cela et demain, ils vous mépriseront. Ils auront considéré que cette société, cette institution qui n’a rien fait pour eux, est justement la source de leur échec et de leur déchéance. Ces enfants ne devraient pas être dans des abris provisoires, aucun abri provisoire ne devrait d’ailleurs exister sur l’ensemble du territoire national. Il faut que nous travaillions à réduire ces disparités, à les faire disparaître complètement parce que les inégalités sont criardes à l’école et il est peut-être temps de les faire disparaître.
Source : lequoitidien.sn